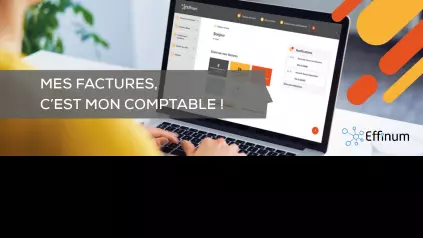La démarche carbone en agriculture : de quoi parle-t-on ?

Publié le 12.11.2025
Revenons aux bases : émissions et stockage de carbone ?

Quand on parle de diagnostic carbone, on parle tout d’abord de gaz à effet de serre, mais pas n’importe lesquels. Les gaz étudiés en agriculture sont le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote. Il est important de comprendre que ces gaz, de par leur composition chimique, n’ont pas la même capacité à réchauffer l’atmosphère : on appelle cet indicateur le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG). A titre d’exemple, les PRG du CO2, du CH4 et du N2O sont respectivement de 1, 28 et 265. Cela signifie que pour une même quantité de gaz, le protoxyde d’azote est 265 fois plus impactant que le CO2. Pour pouvoir comparer les effets des gaz et évaluer les émissions, on doit donc tenir compte de leur PRG : on les exprime en équivalents CO2.
A noter que les émissions étudiées sont de 2 types : les émissions directes, dues aux activités sur l’exploitation, et les émissions indirectes, dues à la fabrication et au transport des intrants. Le devenir de la production, lui, n’entre pas dans le périmètre d’évaluation.
Mais le calcul des émissions ne suffit pas pour obtenir l’empreinte carbone nette : il faut leur soustraire le stockage de carbone. Mais d’où vient ce stockage ? Il est issu du bilan entre les entrées et les sorties de matière organique dans le sol et s’évalue sur du long terme. Ainsi, la présence de couverts d’interculture ou encore l’épandage de matière organique permettent de stocker du carbone. Au contraire, le labour et la récolte sans restitution des résidus engendrent un déstockage. La balance entre les 2 donne le stockage de carbone dans le sol, qui vient en compensation des émissions lorsqu’il est positif.
Alors : Empreinte carbone nette = émissions de GES – stockage de carbone
Qu’est-ce qu’un diagnostic carbone d’exploitation agricole ?
La démarche bas carbone se compose de plusieurs étapes :
Elle commence par un état des lieux initial des émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’activité agricole, et de la compensation permise par le stockage de carbone dans le sol. On étudie à la fois les émissions brutes, le stockage de carbone et l’empreinte carbone nette, à plusieurs échelles : exploitation, ateliers et postes plus précis.
L’objectif est alors d’établir un plan d’action afin de réduire l’empreinte carbone nette de l’exploitation, en réduisant les émissions de GES et/ou en augmentant le stockage de carbone. Pour être réaliste et efficient, le plan d’action doit permettre de réduire les impacts de l’exploitation sur son environnement, tout en tenant compte de sa vulnérabilité aux aléas climatiques et de ses contraintes sociales et économiques.
Pourquoi faire un diagnostic carbone ?
Les intérêts de la démarche bas carbone sont multiples :
Le diagnostic est un outil qui permet non seulement de comprendre les impacts de son activité sur l’environnement, mais également de se comparer avec des exploitations similaires, afin de se positionner et d’identifier les points forts et les points d’amélioration. Il permet d’évaluer la performance de l’exploitation sur de nombreux critères, tant sur le volet carbone que sur d’autres indicateurs environnementaux (biodiversité, consommation d’énergie, qualité de l’eau et de l’air…) mais aussi sur le plan technique (performance reproductrice, autonomie alimentaire, efficience de l’azote…). Ainsi, il permet de prendre du recul sur son activité et d’avoir une vision globale de l’exploitation.
A noter que performances technique, économique et environnementale sont intimement liées : une exploitation très technique est souvent également très efficiente économiquement et voit ses impacts environnementaux réduits. Le plan d’action carbone peut donc permettre d’améliorer la performance globale de l’exploitation, et pas seulement son empreinte carbone.
Ainsi, la démarche bas carbone est l’occasion de faire le point avec un conseiller qui connaît votre activité, le territoire et ses spécificités, avec une compréhension globale des enjeux de l’exploitation. Avoir un regard extérieur permet de se questionner sur ses pratiques et d’aider à la décision, notamment lorsque des projets ou des changements importants sont en réflexion. Ce bilan est d’autant plus important que les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles, avec la nécessité de s’adapter pour accroitre la résilience des exploitations.
Enfin, le diagnostic carbone peut apporter une contribution financière, par 2 voies : dans le cadre de subventions à l’investissement (par exemple FEADER), en apportant des points supplémentaires aux projets ; par l’obtention du Label Bas Carbone et la vente de crédits carbone. Il est important de noter que les gains financiers ne sont jamais garantis à l’avance, mais ils peuvent appuyer un projet ou apporter un complément de revenu si le plan d’action le permet.
Vous souhaitez en savoir plus sur le diagnostic carbone ou être accompagné dans votre démarche ? N’hésitez pas à nous contacter :
Maylis GRUET, Conseillère Environnement
mgruet@dessavoie.cerfrance.fr